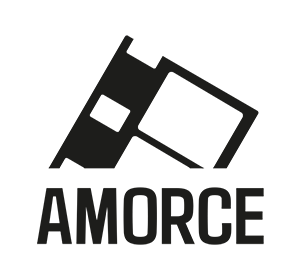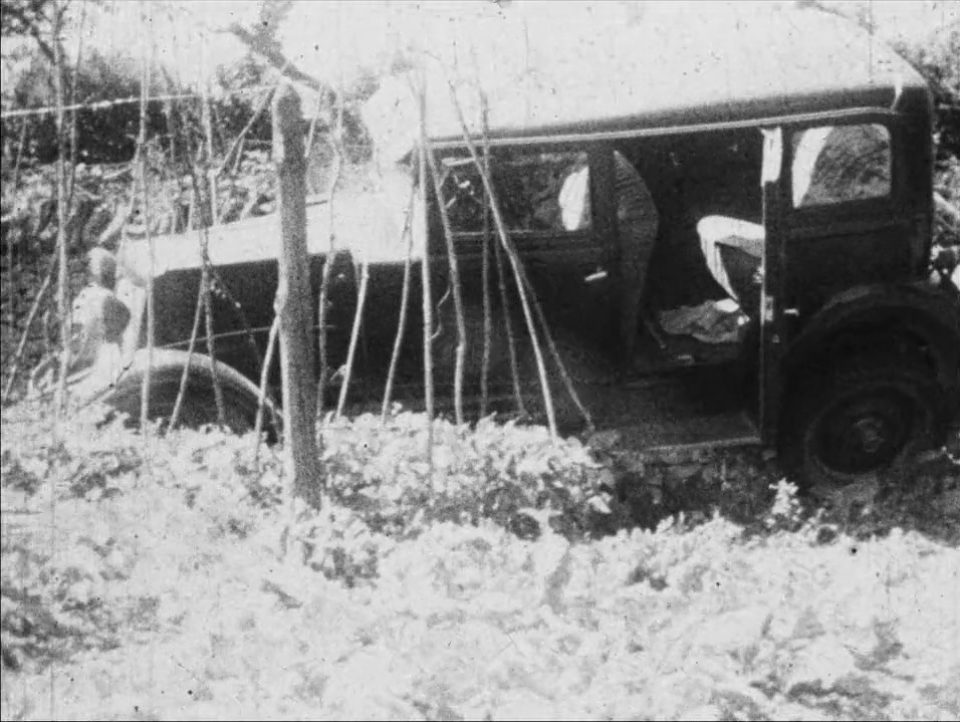
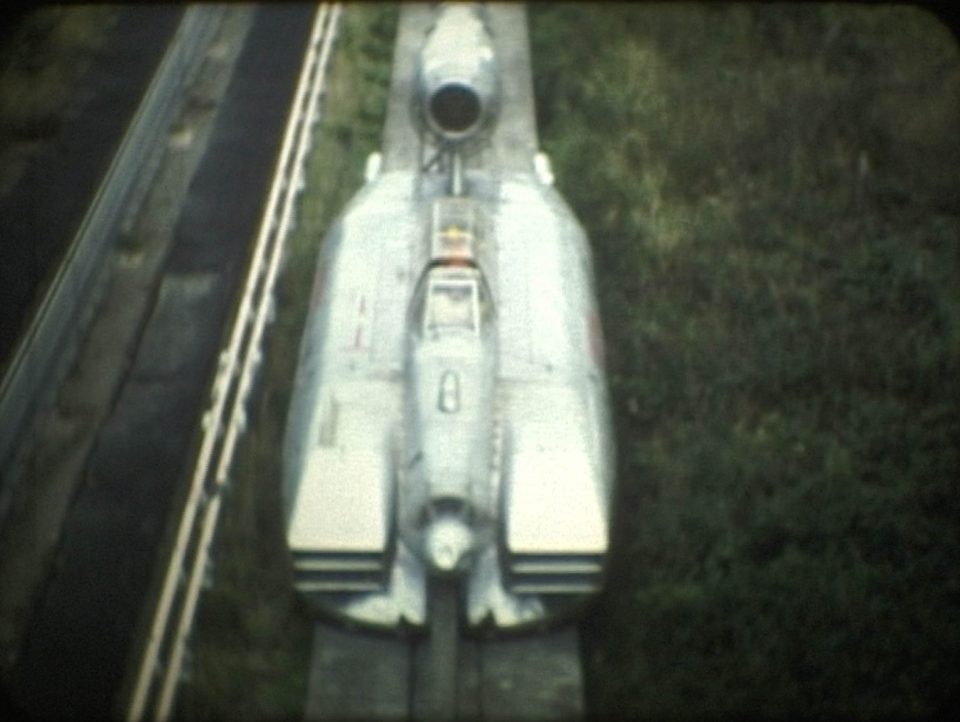






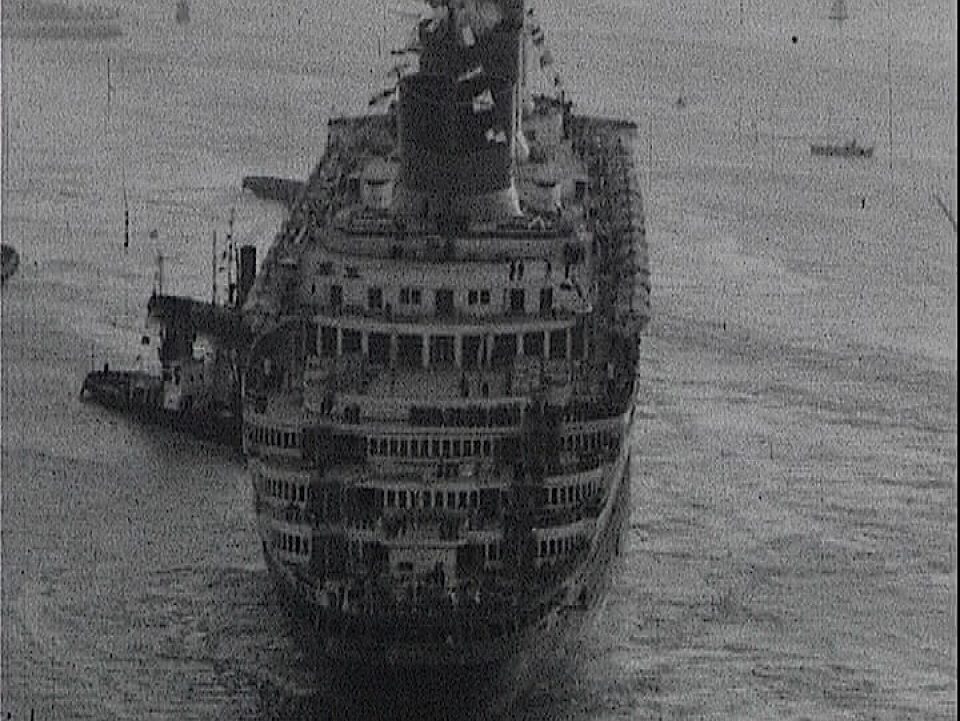

Carte blanche : Le « progrès » des réseaux de transport interrogé par la mémoire filmique des territoires
Par Cyprien Richer, chargé de recherches, Cerema, CY Cergy Paris Université ; Laboratoire Matris (Mobilités, Aménagement, Transports, Risques et Société), F-59000 Lille, France, 03/11/2025
« Celui qui n’avance pas, recule au sein du progrès ». Cette phrase est prononcée par la voix off du film de la Fondation Autrefois Genève sur les transports genevois (1963). Elle exprime l’idée que le progrès est intimement lié au mouvement ; et que l’immobilité fait figure de recul dans la marche de l’histoire. La mobilité n’a pas comme seul objectif de transporter les biens et les personnes ; selon Arnaud Passalacqua, elle permet d’incarner les espoirs politiques, les espérances économiques, les croyances en un progrès matérialiste[1]. La révolution industrielle s’est forgée avec l’avènement des transports ferroviaires (de l’énergie, des marchandises, des personnes) tandis que les Trente Glorieuses nous plongent dans une économie plus libérale et mondialisée dont l’automobile est l’un des marqueurs les plus puissants ; jusqu’aux périodes contemporaines où la grande vitesse accompagne un monde hypermétropolisé mais de plus en plus vulnérable.
Cette sélection de 15 archives audiovisuelles nous invite à explorer une période de grande transformation de la mobilité des années 1920 aux débuts des années 1980 : soixante ans qui raconte une grande évolution des transports de l’ère industrielle (tramway, train, transport fluvial) vers l’automobilité généralisée de la fin du XXème siècle. L’un des intérêts majeurs de la mosaïque de films est de donner à voir différentes phases du développement des réseaux de transport. En effet, des recherches dans le domaine des transports s’appuient sur la théorie des réseaux développée par Gabriel Dupuy[2] et notamment le modèle générique des réseaux techniques, ici mobilitaires. Que l’on aborde ces témoignages sur les transports sous l’angle des infrastructures (canaux, rails, routes...), des véhicules (tramway, autobus, aéroglisseur, aérotrain, péniche...) ou des services (gestion et régulation des mobilités), ces archives attestent d’une phase bien particulière du développement des réseaux.
Le modèle générique de développement des réseaux adapté de l’article de Jean-Marc Offner[3], peut être résumé par les étapes suivantes : la « gestation » (0) du projet de transport avant sa mise en service pouvant donner lieu à des tests et des innovations ; la « naissance » (1) lorsque le nouveau réseau débute son exploitation commerciale ; le « développement initial » (2), pouvant donner lieu à une croissance rapide si les conditions sont réunies ; la « maturité » (3), parfois marquée par l’hégémonie ou le monopole, quand le réseau atteint son apogée ; le « déclin » (4) souvent lié à une concurrence interne ou externe qui nécessite une transformation ou un redéploiement du réseau ; et enfin, si la restructuration n’a pas eu l’effet escompté et permis d’atteindre une nouvelle phase d’équilibre, la « disparition » (5) est l’étape ultime.
Les films collectés par les cinémathèques et le centres d'archives du réseau Diazinteregio, et mis en commun sur la plateforme Amorce, sont un condensé des étapes de développement des transports.
– Phase de gestation d’un réseau (0)
Avant toute naissance, il y a une phase de gestation. La plus célèbre est celle de l’aérotrain de l'ingénieur Jean Bertin décrite dans le film Cinéam-Mémoire filmique d'Île de France. Le documentaire revient sur les premiers essais à échelle réelle à partir de 1965 sur un tronçon expérimental installé entre Gometz-la-Ville et Limours, dans l’Essonne. Qualifié de « belle utopie », l’aérotrain est une illustration de l’adage français : « on a pas de pétrole mais on a des idées ! ». A une époque où la crise pétrolière incitait des pays à maîtriser l’usage des voitures thermiques et relancer le vélo comme aux Pays-Bas, la France se construisait une mythologie autour de l’invention de systèmes de transport de pointe comme l’observe dans ses travaux Arnaud Passalacqua. Ce récit national offre de belles réponses technologiques à des questions sociétales bien mal posées. D’ailleurs l’aérotrain ne passera jamais l’étape de la mise en service commerciale.
Autre véhicule en gestation, le fantasque Carling Home n°2 de l’inventeur Charles Louvet (1929) est présenté par MIRA, la cinémathèque régionale numérique d’Alsace. Dans cette archive, nous voyons circuler l’ancêtre du camping-car moderne, un véhicule futuriste de 10 mètres de long inspiré de l'aviation. Si les premiers modèles de véhicules habitables existent depuis le début du XXème siècle, il faudra attendre l’après-guerre et les années 1950 pour l’industrialisation des modèles de série dans un contexte plus propice à la diffusion du tourisme en automobile.
– Phase de naissance d’un réseau (1)
La naissance d’un mode de transport est un moment fort où le véhicule rencontre pour la première fois son public. Le film de Normandie Images témoigne du voyage inaugural du paquebot Normandie (1935), véritable fierté nationale. Assemblée aux chantier naval de Saint-Nazaire entre 1931 et 1935, il deviendra le plus grand paquebot du monde à sa mise en service. Symbole de modernité et de puissance, sa carrière sera particulièrement brève puisqu’en 1939, l’exploitation commerciale s’arrête quand la guerre commence.
Autre voyage inaugural dans un tout autre contexte, le métro léger de Lille (1982) n’en est pas moins une grande fierté local pour la métropole lilloise. La technologie du véhicule automatique léger (VAL) a été créée au début des années 1970 au sein de l’université de Lille autour du professeur Gabillard. La rencontre avec les premiers curieux dans le film de l’association ARCHIPOP est un formidable témoignage de l’appropriation sociale de la modernité dans une métropole en pleine mutation. Le métro VAL est d’ailleurs considéré par ses promoteurs comme l’un des symboles de la métropolisation de Lille.
– Phase de développement initial d’un réseau (2)
Les films témoignant du développement initial d’un réseau entre les années 1930 et 1950 concernent l’automobile. Deux archives des années 1930 de la cinémathèque de Saint-Étienne et de Ciclic Centre-Val de Loire montrent des accidents de la route. C’est le témoignage d’une époque où les infrastructures n’étaient pas encore adaptées à l’automobile, où les garages, les stations-service, les dépannages, les secours étaient encore peu développés. Depuis le début du XXème siècle, les « Touring clubs » ou l’Automobile-club de France encouragent la diffusion du tourisme automobile. Michelin édite son premier guide en 1900 et participe à la mise en place d'un système de signalisation (panneaux, indicateurs, cartes), d'un repérage des supports techniques (pompes à essence, garages) et des lieux de haltes (hôtel, restaurants). Les éléments d’un « système automobile » indispensables à l’essor de la pratique se mettent alors en place. A partir de l’après-guerre, tout est prêt pour que l’usage de l’automobile explose. Le film de l’association Ofnibus montre le parcours des vacances en 1949 de Paris vers un petit village du Jura. La voiture est ici présentée comme un objet fétiche, au centre de l’attention et du parcours. La signalisation atteste d’une nouvelle géographie des territoires, à hauteur d’automobiles. La modernité que la voiture véhicule contraste avec les traversés de villages et ses charrettes à bras ou à cheval, ses vélos et ses tours de mulet. Certains y verront deux France, celle de la civilisation urbaine où la modernité automobile, d’abord élitiste, se développe ; et celle des villages, encore dépendants de modes de transport archaïques. Cette opposition est réductrice car la motorisation va finir par déferler dans les campagnes ; 1957 sera même une année record de vente de tracteurs[4].
– Phase de maturité d’un réseau (3)
La phase de maturité concerne particulièrement le film d'Image'Est sur l'industrie des tramways à Nancy en 1929. Ce documentaire de 46 minutes démontre avec force la performance et la technicité du réseau de tramway. Celui-ci atteint son apogée en 1925 avec douze lignes totalisant 92 km de longueur. Il est présenté dans le reportage comme « un instrument de travail indispensable aux grandes cités modernes » et « un moyen de communication économique et rapide avec la grande banlieue ». Cet âge d’or du « tout tramway » ne va cependant pas durer : dès 1935, le remplacement du tramway par des autobus est déjà envisagé à Nancy. Le démantèlement du réseau de tramway débute avant la guerre et s’accélère ensuite.
Une autre expression d’une phase de maturité d’un réseau est disponible dans les collections d'Archipop. Il montre l’exploitation de l’aéroglisseur Hoverlloyd en 1969 pour le trafic transmanche entre Calais et Ramsgate en Angleterre. La séquence illustre la performance de ce véhicule amphibien, à portance aérostatique et à propulsion aérienne. L’habitacle des passagers avec ses hôtesses de bord donne l’impression d’être à bord d’un transport aérien. Ces navettes plus rapides que les ferries traditionnels, développées dans les années 1960, atteignent leur apogée dans les années 1970 avec un très haut niveau de fiabilité et de sécurité. En octobre 2000, après 32 ans d’exploitation, les hovercrafts effectuaient leur toute dernière traversée. Le coût de l’exploitation, la consommation de kérosène et la concurrence du tunnel sous la Manche, inauguré en 1994, aura eu raison de ce transport iconique de l’histoire franco-britannique.
– Phase de déclin d’un réseau (4)
La phase de déclin la plus spectaculaire et touchante de la sélection est celle de la batellerie artisanale en 1985. Un document du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir donne la parole aux travailleurs du fluvial au coeur d’un conflit social. Les bateliers évoquent la dureté de leur travail et la concurrence « déloyale » du train et de la SNCF largement subventionnée. « Paris, ça fera un très beau cimetière de bateau ». Au centre de la capitale, la détresse de la batellerie, activité artisanale et familiale, contraste avec le passage des « Bateaux-mouches » remplis de touristes.
Autre déclin visible dans la sélection, celui des trains de desserte fine du territoire. Un film de la cinémathèque de Bretagne (1966) montre le trajet du dimanche en Bretagne vers les plages de la presqu’île de Crozon. La vieille machine à vapeur circulant à faible vitesse sur un chemin de fer vieillissant ne sera pas sauvée par l’attachement social perceptible dans ce court métrage. Son insertion dans le paysage semble pourtant fusionnelle et intemporelle. La ligne est fermée et démantelée seulement 2 ans après ce film, en 1968. La contraction du réseau ferroviaire « capillaire » va être rapide à cette époque comme le montre la thèse de Christophe Mimeur[5]. Clin d’oeil de l’histoire, la même année que le film de Jean Lazennec, la SNCF lançait une étude sur les « possibilités ferroviaires à très grande vitesse sur infrastructures nouvelles » qui aboutira à la mise en service du TGV en 1981. Sacré contraste !
Un film montre la transformation d’un réseau : c’est le documentaire de la Fondation Autrefois Genève (1963) qui présente l’activité de la Compagnie Genevoise des Tramways Électriques : tramway, trolley, autobus composent un réseau complémentaire et moderne pour l’époque. À cette période, les lignes de tramway ont presque toutes été supprimées au profit de l’autobus, plus souple à exploiter : « il ne reste plus que 2 lignes de tramway : la ceinture et la 12 ». L’avantage de l’autobus réside dans le faible coût en infrastructures qu’il implique pour les compagnies puisque l’entretien de la route est à la charge de la puissance publique. La souplesse de l’autobus, qui peut modifier son parcours en s’affranchissant des rails et du fil aérien, est aussi porté à son crédit[6]. En 1969, la ligne 12 présentée dans l’archive sera la dernière ligne survivante du réseau grâce à son fort trafic. C’est aujourd’hui la plus ancienne ligne de tramway d'Europe encore en activité. Signe que l’histoire balbutie, le réseau de tramway de Genève, après cette phase de déclin, va retrouver une phase de développement dans les années 1990.
– Phase de disparition d’un réseau (5)
Le déclin des réseaux de tramway ira jusqu’à leur disparition totale dans la plupart des agglomérations françaises. A titre d’exemple, la marche du dernier tramway à Nancy est archivée par Image’Est. En 1958, le réseau de tramway disparaît définitivement après 84 ans de fonctionnement. Le démantèlement des réseaux de tramway en France, jusqu'aux années 1960, est lié à un ensemble de facteurs : l’image des autobus, la concurrence dans la rue avec la voiture mais aussi des aspects financiers, réglementaires ou territoriaux (mutations résidentielles). Ces films sont là pour conserver la mémoire des transports ; et cette mémoire nous permet de cultiver notre esprit critique sur l’évolution de la mobilité.
Pour conclure, les archives mises en commun sur la plateforme Amorce donnent à voir « l’invisible » de la mobilité : « Les citadins et les campagnards se sont-ils seulement demandés quelle somme d’efforts a coûté la présence d’un véhicule au rendez-vous que lui fixe chaque jour des milliers d’usagers ? » (Extrait du film de la Fondation Autrefois Genève, 1963). De nombreuses archives audiovisuelles montrent la face cachée des métiers dans les bureaux, les ateliers, des dépôts... là où travaillent les services d'exploitation, du mouvement, des ateliers, des voies, de l’énergie électrique. Grâce à cette mémoire filmique, il est possible de mesurer l’importance du rôle de ces agents sans qui le transport serait impossible. Ces métiers ont d’ailleurs beaucoup évolué selon le développement des réseaux (gestation, naissance, développement initial, maturité, déclin, disparition) faisant apparaitre des tensions sociales sur les conditions de travail comme avec les bateliers (Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, 1985) ou les agents grévistes en gare de l’Est (Ciné-Archives, 1968).
Ces archives nous invitent surtout à prendre de la hauteur face à la marche du progrès dans le transport. Chaque époque véhicule des valeurs et des représentations que nos sociétés prennent rarement le temps de comprendre. De quel progrès parle-t-on ? Le progrès de la voiture thermique pour tous ? Le progrès de la motorisation à outrance des campagnes agricoles ? Le progrès de l’autobus qui reléguait le tramway dans les reliques des transports urbains ? Le progrès des grands réseaux (grande vitesse dans le ferroviaire, grand gabarit dans le fluvial) au détriment des dessertes fines du territoire ? Les époques portent une mécanique de progrès qu’il est difficile de ralentir ou de contester. D’où l’importance de la mémoire, ici filmique, pour repenser nos choix présents à la lumière des apprentissages du passé.
[1] https://journals.openedition.org/ephaistos/7696
[2] https://www.persee.fr/doc/spgeo_0046-2497_1987_num_16_3_4241
[3] https://www.persee.fr/doc/flux_1154-2721_1993_num_9_13_960
[4] https://shs.cairn.info/histoire-des-transports-et-des-mobilites-en-france--9782200634315
Baldasseroni, L., Faugier, É. et Pelgrims, C. (dir.) (2022). Histoire des transports et des mobilités en France : XIXe-XXIe siècle. Armand Colin.
[5] https://theses.hal.science/tel-01451164v2/file/these_A_MIMEUR_Christophe_2016.pdf
[6] https://shs.cairn.info/histoire-des-transports-et-des-mobilites-en-france--9782200634315
Baldasseroni, L., Faugier, É. et Pelgrims, C. (dir.) (2022). Histoire des transports et des mobilités en France : XIXe-XXIe siècle. Armand Colin.