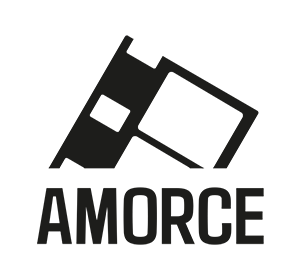Petite fiction qui met en scène l'escapade buissonnière d'un garçon à la campagne, dans le Pays de Caux.
L'enfant (le fils du filmeur) joue le rôle d'un petit fugueur. Il est organisé avec un sens du découpage et du montage.
En gros plan, un éventail japonisant se replie pour laisser apparaître le titre "L'escapade de Michel". Des volets intérieurs d'une chambre s'ouvrent. Le réveil affiche 7 Heures. Un petit garçon se réveille en se frottant les yeux, il contient mal son sourire de devoir jouer la comédie. Il s'étire, enfile ses sandales. Sa mère le débarbouille énergiquement. Le voilà dans un pré avec des vaches. Il court après les moutons et les poules. Puis il ouvre une barrière et s'aventure dans les champs , il suit une charrette qui transporte une citerne de lait et regarde une moissonneuse batteuse en pleine action. Il se promène au milieu des ballots de blé qui sont plus grands que lui. Il élit une meule, pose sa veste par terre pour ne pas être piqué par le foin coupé et s'installe pour une sieste. Mais il est bientôt délogé par les paysans qui travaillent. Michel picore des grains de blé à un épi. Il sort une cruche et un verre du cœur d'une meule et se sert à boire. Puis il part en courant dans la profondeur des champs. Le fermier, béret vissé sur la tête et mégot à la bouche manœuvre sa moissonneuse et repart lui aussi.
EN COMPLÉMENT :
Au début du XXe siècle les campagnes normandes, en particulier la campagne cauchoise, souffrent durement de l’exode rural qui a débuté mi-XIXe (départ d’abord des tisserands, puis des ouvriers agricoles vers les villes industrielles). Une des causes principales de ces départs est l’essor du machinisme et donc de la mécanisation (semoirs, faucheuses, faneuses, moissonneuses d’abord tirées par des chevaux, puis à moteur, etc).
A partir du milieu de la décennie 1970, l’élevage bovin commence à décroître en Normandie (surproduction de lait, contraintes des mises aux normes européennes...), d’où le recul des surfaces en prairies permanentes au profit des céréales (blé, orge) et des cultures industrielles (colza, lin, pomme de terre). En particulier les surfaces consacrées au lin ont beaucoup augmenté depuis 1945, notamment sous l’influence de l’arrivée d’agriculteurs belges.
L'enfant (le fils du filmeur) joue le rôle d'un petit fugueur. Il est organisé avec un sens du découpage et du montage.
En gros plan, un éventail japonisant se replie pour laisser apparaître le titre "L'escapade de Michel". Des volets intérieurs d'une chambre s'ouvrent. Le réveil affiche 7 Heures. Un petit garçon se réveille en se frottant les yeux, il contient mal son sourire de devoir jouer la comédie. Il s'étire, enfile ses sandales. Sa mère le débarbouille énergiquement. Le voilà dans un pré avec des vaches. Il court après les moutons et les poules. Puis il ouvre une barrière et s'aventure dans les champs , il suit une charrette qui transporte une citerne de lait et regarde une moissonneuse batteuse en pleine action. Il se promène au milieu des ballots de blé qui sont plus grands que lui. Il élit une meule, pose sa veste par terre pour ne pas être piqué par le foin coupé et s'installe pour une sieste. Mais il est bientôt délogé par les paysans qui travaillent. Michel picore des grains de blé à un épi. Il sort une cruche et un verre du cœur d'une meule et se sert à boire. Puis il part en courant dans la profondeur des champs. Le fermier, béret vissé sur la tête et mégot à la bouche manœuvre sa moissonneuse et repart lui aussi.
EN COMPLÉMENT :
Au début du XXe siècle les campagnes normandes, en particulier la campagne cauchoise, souffrent durement de l’exode rural qui a débuté mi-XIXe (départ d’abord des tisserands, puis des ouvriers agricoles vers les villes industrielles). Une des causes principales de ces départs est l’essor du machinisme et donc de la mécanisation (semoirs, faucheuses, faneuses, moissonneuses d’abord tirées par des chevaux, puis à moteur, etc).
A partir du milieu de la décennie 1970, l’élevage bovin commence à décroître en Normandie (surproduction de lait, contraintes des mises aux normes européennes...), d’où le recul des surfaces en prairies permanentes au profit des céréales (blé, orge) et des cultures industrielles (colza, lin, pomme de terre). En particulier les surfaces consacrées au lin ont beaucoup augmenté depuis 1945, notamment sous l’influence de l’arrivée d’agriculteurs belges.