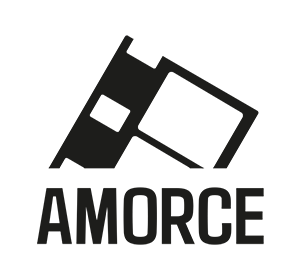Bénodet 1960
Cinémathèque de Bretagne
1960 | Documentaire
- 00:24:04
BENODET
Les Années 1960 environ
---------
Analyse du film faite par Mme Jacqueline Jacq (née Le Garrec)
L’estuaire de l’Odet, appelée « la plus belle rivière de France » ! Cela est peut être un peu présomptueux ! Mais à chacun son point de vue. C’est vrai, elle est belle, particulièrement dans un passage « les vires courts ». Depuis l’ouragan de 1987 la nature s’est un peu dégarnie mais la promenade reste très jolie. De nombreuses légendes s’y rattachent. Fernand Le Garrec et Jean Bedouet en ont fait un film couleur sonore et commenté dont le titre est « L’Odet » (de sa source à son embouchure).
Les deux berges : côté Benodet, côté Sainte Marine. Sur l’une des vues de Ste Marine, sans doute prise du haut du grand phare de Benodet, on passe au dessus de la végétation ; on voit donc la mer de l’autre côté. Nous sommes là, non plus en pays Fouesnantais mais en pays Bigouden. La grande courbe est la très belle plage allant de Ste Marine à L’Ile Tudy. L’Ile Tudy n’est pas une île mais une presqu’île. Cette petite station balnéaire a conservé tout son charme d’autrefois : maisons basses et petites, ruelles sans doute pour s’abriter au maximum des vents du large. Les noms des rues sont amusants, simples et très évocateurs : rue des pêcheurs, rue des tempêtes, rue de la mairie, rue des mouettes…
La petite plage de Benodet le long de l’Odet, juste à l’estuaire. Une grosse balise verte pour les bateaux et connue de tous : « LE COQ ». Peu de bateaux au mouillage. Des dériveurs rangés en haut de la plage. Au dessus de la plage, la Corniche de l’estuaire est bordée de végétation nature avec ses plantes, ses herbes, ses ronces…Tout cela a fait place à une promenade entièrement aménagée pour piétons et poussettes.
Le port : lui aussi peu de bateaux, pas d’aménagement de pontons comme actuellement. Pontons, densité des bâteaux, leur taille aussi : une très grande évolution. Au mouillage une Arcoa (ou un Matona ?)
Le bac gris, un bac à chaînes, arrivant à sa cale, une image incontournable de ce Benodet. Ce bac transportait voitures, cars et piétons. Il contenait 8 voitures normales ou 10 petites, rangées sur deux files. Il était le seul moyen, en ce lieu, de passer du pays Fouesnantais en pays Bigouden. Sans lui, il fallait aller chercher un pont à Quimper et faire donc un détour de 32 à 35 KM. Dans ses dernières années d’existence il était devenu totalement insuffisant entraînant des files d’attente et donc des délais d’attente insupportables. Autour de toute une polémique (certains pour, certains contre) un pont fût construit rendant les plus grands services à la population et rapprochant ainsi Fouesnantais et Bigoudens, « grands rivaux » d’autrefois !
Au port de Ste Marine on aperçoit un bâtiment rose : « l’abri du marin ». Ces « abris du marin » construits dans les ports à l’initiative de Jacques De Thézac afin de venir en aide aux familles de marins.
D’une cale, partaient déjà des bateaux promenades pour les touristes. Ici, « La Perle de l’Odet ». Ce n’était pas les « aigrettes » actuelles ! Les billets se prenaient sur la cale directement. Actuellement un beau bureau permet de les acheter.
Pas loin de la cale du bac, une autre cale, celle des bateaux promenades pour les touristes. Là, une bigoudène, en coiffe, offre à la vente, ses dentelles, ses napperons et ses colliers de coquillages…
Dans une barque, un monsieur, debout, barbe blanche, casquette : il s’agit de Monsieur Craff, propriétaire d’un chantier naval à Benodet et constructeur des célèbres Cravelles et Cragogne. Il était spécialisé dans la construction en bois et contre-plaqué :
- Vauriens-corsaires-caravelles en contre-plaqué.
- Super-challenger en bois moulé.
- Cygnes en bois.
- Côtre des Glénans en bois.
- Bateau à l’unité, donc des plans uniques.
- Des belles vedettes pour la marine nationale.
Les bateaux étaient mis à l’eau sur la plage de Benodet par un chemin en bois qu’il avait fabriqué.
La grande plage de Benodet, dans sa baie, tournée vers le large. En face, en mer, les îles des « moutons » à 6 miles de Benodet et les îles des « Glénans » à 10 miles de Benodet.
Dans le haut de la plage, les cabines en bois. Il n’y avait ni douches ni WC, tout cela a été remplacé par une ligne ininterrompue de cabines en dur très convoitées par les habitués. Douches et WC ont été aménagés.
On aperçoit la partie de la plage vers la pointe, c’est l’anse du Trez : c’était nettement moins construit.
Il en est de même d’une avenue que l’on voit après : il y a encore des champs ; actuellement tout est construit. A l’époque il était possible d’aller chercher des mûres en plein centre de Benodet !
Moments de la vie quotidienne pendant les vacances
La famille Le Garrec avaient de nombreux amis à Bénodet. Certains petits moments ont été filmés : travaux de peinture. lecture et « salon » au jardin.
Une petite maison de vacances, travaux au jardin : confection d’un dallage et résultat du travail.
En face, le magasin de Etienne le Grand photographe à Quimper, magasin ouvert pendant la saison.
Séquence du vélomoteur.
M. Le Garrec et son ami de vacances, Jean Vacher, aimaient s’amuser et faire des sketches, d’ailleurs plus ou moins réussis ! Celui-ci en est un.
Jacqueline Le Garrec et son amie avaient obtenu, avec beaucoup de difficultés (les 2 roues étant par définition très dangereux !), l’achat de « mobylette ». Son cousin, de son côté avait une petite moto 50cc de l’époque (style Flandria).
« Les deux jeunes filles, un jour, tombèrent en panne et bien évidemment se trouvèrent désemparées au bord de la route. Le hasard fit bien les choses, faisant passer par là un beau jeune homme blond sur sa rutilante moto rouge. Sans hésitation, bien sûr, il s’arrêta pour dépanner ces deux personnes en détresse ». Les mobylettes marchaient avant, elle marchèrent aussi et heureusement après. La scène dut être rejouée à plusieurs reprises sur demande du cinéaste !!
On peut remarquer que le jeune homme porte un casque, sans doute bien éloigné des normes actuelles mais que les deux jeunes filles n’en n’ont pas. Les règles de sécurité étaient loin d’être les mêmes !
Le Vaurien
Parmi les dériveurs, ce fut l’ère du vaurien. Jacqueline Le Garrec en possédait un et, avec une amie, passaient, comme beaucoup d’autres, les après-midi sur l’eau par tous les temps. Les tâches étaient bien réparties : Jacqueline à la barre et son équipière au foc.
A l’époque, on faisait du dériveur sans combinaison et sans gilet de sauvetage.
Sortie du hors-bord bleu de l’eau
Cela se passait à la cale du bac. Une bande de jeunes, parents et amis aident à la manœuvre, dirigés par Jean Vacher, grand ami d’été des Le Garrec. Pendant les vacances, le hors bord (un Rocca probablement) était au mouillage à une bouée située pas très loin du bac.
Il s’agit vraisemblablement de la sortie de fin de vacances. Mais les pannes de moteur hors-bord étaient relativement fréquentes, entraînant bien des désagréments pendant les vacances.
La Vespa 400 bleu canard
Ce fut la première voiture de Jacqueline, voici ce qu’elle en dit :
« Un vrai danger public ! Aucune puissance, pas de reprise, s’étouffant à chaud. Pourtant je faisais un peu de route et n’hésitais pas à dépasser des camions : il me fallait beaucoup beaucoup de temps ! insouciance de la jeunesse sans doute. »
Par contre, dans Benodet, pour le transport des skis, des personnes et des chiens, la Vespa 400 était très adaptée : décapotable, ouverte au vent, au soleil ou aux embruns, elle remplissait parfaitement son rôle. On pouvait y charger : 1 paire de skis, 1 monoski, 3 personnes, 2 chiens.
M. Vacher en profite pour faire le pitre à la fin de la séquence.
La plage le ski nautique
Dans le haut de la plage la dune. Actuellement, la dune n’existe plus. L’endroit a été aménagé en superbe promenade pour piétons et poussettes. Derrière, ont poussé, le Casino, la thalasso, le cinéma.
« Nous étions un groupe de jeunes, parents et amis, à nous retrouver pratiquement tous les jours pour faire nos tours de ski. Nous en faisions, chacun, 1 ou 2, voir 3, selon les conditions de temps, d’humeur, de forme. Le hors-bord appartenait à mon père. Un ami, faisant déjà du ski, lui avait appris à nous tirer. Bien que ne pratiquant pas ce sport, il tirait très bien tant au démarrage qu’après, ainsi qu’en retour à la plage. Son lieu de travail était à une trentaine de km de Benodet. Prenant peu de vacances, son plaisir était, pendant la période d’été, de rentrer plus tôt. Nous avions tous rendez vous vers 17h-17h30 au bout de la plage du Trez. Les jeunes s’occupaient des skis et là, pendant 1h30 à 2 heures nous faisions nos tours les uns et les autres. Certains pratiquaient sur 2 skis, d’autres sur mono, souvent seul, parfois à 2 voir 4 comme le montre l’une des vues. Là non plus, je ne parle pas de la sécurité : ni combinaison, ni gilet de sauvetage, en maillot. A cette époque c’était ainsi. Cependant une bonne habitude avait été adoptée : il y avait toujours 2 personnes dans le bateau, l’une conduisant, l’autre surveillant le skieur. Cette mesure permettait de récupérer le skieur le plus rapidement possible en cas de chute, et les chutes étaient évidemment nombreuses ! »
A l’époque, les départs de la plage et les retours étaient autorisés ce qui ne l’est plus de nos jours.
La plage
On y va par tous les temps en dehors des tempêtes évidemment. En cas de fort vent, les parasols sont couchés à même le sable. Il n’existait pas de zone pour les bateaux qui partaient et accostaient là où ils le désiraient. Les planches à voile n’existaient pas, par contre on peut observer un Catamaran
Bateaux
Une régate de « Corsaires », bateaux très en vogue à cette époque. (régate ventée).
On y voit aussi un vaurien, un « requin » qui empanne à la bouée.
Pas de planches à voile : elles n’existaient pas. Par contre on peut observer pour la deuxième fois une nouveauté pour l’époque : un catamaran. Celui-ci est un Shearwater III, créé à la fin des années 50 par Roland et Francis Prout en Angleterre, ce catamaran commence à connaître un certain engouement en 1960 près de 2000 unités seront construites). On peut égalemnt voir un 615, dériveur très recent pour l’époque, le reste est très classique : corsaire, vaurien, requin.
Le film se termine par la première d’un spectacle nocturne qui deviendra plus tard une célèbre manifestation très prisée aujourd’hui et qui rassemble chaque 15 août une marée humaine. Il était simple à cette époque : feux de Bengale sur l’eau et à terre, à bord des bateaux, démonstration de ski à 4. La soirée se terminait par un feu d’artifice classique.
Ces premières « nuits de l’Odet » eurent lieu tous les ans, et furent à l’origine de « la féerie nautique » actuelle.
D’après Jacqueline Jacq à Benodet, le 18/10/2006
(vu par Gilbert le Traon le 18/12/2006)
Bénodet, dans les années 60. Ce film de Fernand et Jacqueline Le Garrec, entre documentaire et film de famille, est très riche d'informations sur la vie des stations balnéaires du Sud-Finistère. Bénodet est déjà une ville attachée à la plaisance sportive : vauriens, caravelles, corsaires, requins et même un 615, et un Shearwater (premier catamaran). Brest 2016 : CLS, 16/6/16
Les Années 1960 environ
---------
Analyse du film faite par Mme Jacqueline Jacq (née Le Garrec)
L’estuaire de l’Odet, appelée « la plus belle rivière de France » ! Cela est peut être un peu présomptueux ! Mais à chacun son point de vue. C’est vrai, elle est belle, particulièrement dans un passage « les vires courts ». Depuis l’ouragan de 1987 la nature s’est un peu dégarnie mais la promenade reste très jolie. De nombreuses légendes s’y rattachent. Fernand Le Garrec et Jean Bedouet en ont fait un film couleur sonore et commenté dont le titre est « L’Odet » (de sa source à son embouchure).
Les deux berges : côté Benodet, côté Sainte Marine. Sur l’une des vues de Ste Marine, sans doute prise du haut du grand phare de Benodet, on passe au dessus de la végétation ; on voit donc la mer de l’autre côté. Nous sommes là, non plus en pays Fouesnantais mais en pays Bigouden. La grande courbe est la très belle plage allant de Ste Marine à L’Ile Tudy. L’Ile Tudy n’est pas une île mais une presqu’île. Cette petite station balnéaire a conservé tout son charme d’autrefois : maisons basses et petites, ruelles sans doute pour s’abriter au maximum des vents du large. Les noms des rues sont amusants, simples et très évocateurs : rue des pêcheurs, rue des tempêtes, rue de la mairie, rue des mouettes…
La petite plage de Benodet le long de l’Odet, juste à l’estuaire. Une grosse balise verte pour les bateaux et connue de tous : « LE COQ ». Peu de bateaux au mouillage. Des dériveurs rangés en haut de la plage. Au dessus de la plage, la Corniche de l’estuaire est bordée de végétation nature avec ses plantes, ses herbes, ses ronces…Tout cela a fait place à une promenade entièrement aménagée pour piétons et poussettes.
Le port : lui aussi peu de bateaux, pas d’aménagement de pontons comme actuellement. Pontons, densité des bâteaux, leur taille aussi : une très grande évolution. Au mouillage une Arcoa (ou un Matona ?)
Le bac gris, un bac à chaînes, arrivant à sa cale, une image incontournable de ce Benodet. Ce bac transportait voitures, cars et piétons. Il contenait 8 voitures normales ou 10 petites, rangées sur deux files. Il était le seul moyen, en ce lieu, de passer du pays Fouesnantais en pays Bigouden. Sans lui, il fallait aller chercher un pont à Quimper et faire donc un détour de 32 à 35 KM. Dans ses dernières années d’existence il était devenu totalement insuffisant entraînant des files d’attente et donc des délais d’attente insupportables. Autour de toute une polémique (certains pour, certains contre) un pont fût construit rendant les plus grands services à la population et rapprochant ainsi Fouesnantais et Bigoudens, « grands rivaux » d’autrefois !
Au port de Ste Marine on aperçoit un bâtiment rose : « l’abri du marin ». Ces « abris du marin » construits dans les ports à l’initiative de Jacques De Thézac afin de venir en aide aux familles de marins.
D’une cale, partaient déjà des bateaux promenades pour les touristes. Ici, « La Perle de l’Odet ». Ce n’était pas les « aigrettes » actuelles ! Les billets se prenaient sur la cale directement. Actuellement un beau bureau permet de les acheter.
Pas loin de la cale du bac, une autre cale, celle des bateaux promenades pour les touristes. Là, une bigoudène, en coiffe, offre à la vente, ses dentelles, ses napperons et ses colliers de coquillages…
Dans une barque, un monsieur, debout, barbe blanche, casquette : il s’agit de Monsieur Craff, propriétaire d’un chantier naval à Benodet et constructeur des célèbres Cravelles et Cragogne. Il était spécialisé dans la construction en bois et contre-plaqué :
- Vauriens-corsaires-caravelles en contre-plaqué.
- Super-challenger en bois moulé.
- Cygnes en bois.
- Côtre des Glénans en bois.
- Bateau à l’unité, donc des plans uniques.
- Des belles vedettes pour la marine nationale.
Les bateaux étaient mis à l’eau sur la plage de Benodet par un chemin en bois qu’il avait fabriqué.
La grande plage de Benodet, dans sa baie, tournée vers le large. En face, en mer, les îles des « moutons » à 6 miles de Benodet et les îles des « Glénans » à 10 miles de Benodet.
Dans le haut de la plage, les cabines en bois. Il n’y avait ni douches ni WC, tout cela a été remplacé par une ligne ininterrompue de cabines en dur très convoitées par les habitués. Douches et WC ont été aménagés.
On aperçoit la partie de la plage vers la pointe, c’est l’anse du Trez : c’était nettement moins construit.
Il en est de même d’une avenue que l’on voit après : il y a encore des champs ; actuellement tout est construit. A l’époque il était possible d’aller chercher des mûres en plein centre de Benodet !
Moments de la vie quotidienne pendant les vacances
La famille Le Garrec avaient de nombreux amis à Bénodet. Certains petits moments ont été filmés : travaux de peinture. lecture et « salon » au jardin.
Une petite maison de vacances, travaux au jardin : confection d’un dallage et résultat du travail.
En face, le magasin de Etienne le Grand photographe à Quimper, magasin ouvert pendant la saison.
Séquence du vélomoteur.
M. Le Garrec et son ami de vacances, Jean Vacher, aimaient s’amuser et faire des sketches, d’ailleurs plus ou moins réussis ! Celui-ci en est un.
Jacqueline Le Garrec et son amie avaient obtenu, avec beaucoup de difficultés (les 2 roues étant par définition très dangereux !), l’achat de « mobylette ». Son cousin, de son côté avait une petite moto 50cc de l’époque (style Flandria).
« Les deux jeunes filles, un jour, tombèrent en panne et bien évidemment se trouvèrent désemparées au bord de la route. Le hasard fit bien les choses, faisant passer par là un beau jeune homme blond sur sa rutilante moto rouge. Sans hésitation, bien sûr, il s’arrêta pour dépanner ces deux personnes en détresse ». Les mobylettes marchaient avant, elle marchèrent aussi et heureusement après. La scène dut être rejouée à plusieurs reprises sur demande du cinéaste !!
On peut remarquer que le jeune homme porte un casque, sans doute bien éloigné des normes actuelles mais que les deux jeunes filles n’en n’ont pas. Les règles de sécurité étaient loin d’être les mêmes !
Le Vaurien
Parmi les dériveurs, ce fut l’ère du vaurien. Jacqueline Le Garrec en possédait un et, avec une amie, passaient, comme beaucoup d’autres, les après-midi sur l’eau par tous les temps. Les tâches étaient bien réparties : Jacqueline à la barre et son équipière au foc.
A l’époque, on faisait du dériveur sans combinaison et sans gilet de sauvetage.
Sortie du hors-bord bleu de l’eau
Cela se passait à la cale du bac. Une bande de jeunes, parents et amis aident à la manœuvre, dirigés par Jean Vacher, grand ami d’été des Le Garrec. Pendant les vacances, le hors bord (un Rocca probablement) était au mouillage à une bouée située pas très loin du bac.
Il s’agit vraisemblablement de la sortie de fin de vacances. Mais les pannes de moteur hors-bord étaient relativement fréquentes, entraînant bien des désagréments pendant les vacances.
La Vespa 400 bleu canard
Ce fut la première voiture de Jacqueline, voici ce qu’elle en dit :
« Un vrai danger public ! Aucune puissance, pas de reprise, s’étouffant à chaud. Pourtant je faisais un peu de route et n’hésitais pas à dépasser des camions : il me fallait beaucoup beaucoup de temps ! insouciance de la jeunesse sans doute. »
Par contre, dans Benodet, pour le transport des skis, des personnes et des chiens, la Vespa 400 était très adaptée : décapotable, ouverte au vent, au soleil ou aux embruns, elle remplissait parfaitement son rôle. On pouvait y charger : 1 paire de skis, 1 monoski, 3 personnes, 2 chiens.
M. Vacher en profite pour faire le pitre à la fin de la séquence.
La plage le ski nautique
Dans le haut de la plage la dune. Actuellement, la dune n’existe plus. L’endroit a été aménagé en superbe promenade pour piétons et poussettes. Derrière, ont poussé, le Casino, la thalasso, le cinéma.
« Nous étions un groupe de jeunes, parents et amis, à nous retrouver pratiquement tous les jours pour faire nos tours de ski. Nous en faisions, chacun, 1 ou 2, voir 3, selon les conditions de temps, d’humeur, de forme. Le hors-bord appartenait à mon père. Un ami, faisant déjà du ski, lui avait appris à nous tirer. Bien que ne pratiquant pas ce sport, il tirait très bien tant au démarrage qu’après, ainsi qu’en retour à la plage. Son lieu de travail était à une trentaine de km de Benodet. Prenant peu de vacances, son plaisir était, pendant la période d’été, de rentrer plus tôt. Nous avions tous rendez vous vers 17h-17h30 au bout de la plage du Trez. Les jeunes s’occupaient des skis et là, pendant 1h30 à 2 heures nous faisions nos tours les uns et les autres. Certains pratiquaient sur 2 skis, d’autres sur mono, souvent seul, parfois à 2 voir 4 comme le montre l’une des vues. Là non plus, je ne parle pas de la sécurité : ni combinaison, ni gilet de sauvetage, en maillot. A cette époque c’était ainsi. Cependant une bonne habitude avait été adoptée : il y avait toujours 2 personnes dans le bateau, l’une conduisant, l’autre surveillant le skieur. Cette mesure permettait de récupérer le skieur le plus rapidement possible en cas de chute, et les chutes étaient évidemment nombreuses ! »
A l’époque, les départs de la plage et les retours étaient autorisés ce qui ne l’est plus de nos jours.
La plage
On y va par tous les temps en dehors des tempêtes évidemment. En cas de fort vent, les parasols sont couchés à même le sable. Il n’existait pas de zone pour les bateaux qui partaient et accostaient là où ils le désiraient. Les planches à voile n’existaient pas, par contre on peut observer un Catamaran
Bateaux
Une régate de « Corsaires », bateaux très en vogue à cette époque. (régate ventée).
On y voit aussi un vaurien, un « requin » qui empanne à la bouée.
Pas de planches à voile : elles n’existaient pas. Par contre on peut observer pour la deuxième fois une nouveauté pour l’époque : un catamaran. Celui-ci est un Shearwater III, créé à la fin des années 50 par Roland et Francis Prout en Angleterre, ce catamaran commence à connaître un certain engouement en 1960 près de 2000 unités seront construites). On peut égalemnt voir un 615, dériveur très recent pour l’époque, le reste est très classique : corsaire, vaurien, requin.
Le film se termine par la première d’un spectacle nocturne qui deviendra plus tard une célèbre manifestation très prisée aujourd’hui et qui rassemble chaque 15 août une marée humaine. Il était simple à cette époque : feux de Bengale sur l’eau et à terre, à bord des bateaux, démonstration de ski à 4. La soirée se terminait par un feu d’artifice classique.
Ces premières « nuits de l’Odet » eurent lieu tous les ans, et furent à l’origine de « la féerie nautique » actuelle.
D’après Jacqueline Jacq à Benodet, le 18/10/2006
(vu par Gilbert le Traon le 18/12/2006)
Bénodet, dans les années 60. Ce film de Fernand et Jacqueline Le Garrec, entre documentaire et film de famille, est très riche d'informations sur la vie des stations balnéaires du Sud-Finistère. Bénodet est déjà une ville attachée à la plaisance sportive : vauriens, caravelles, corsaires, requins et même un 615, et un Shearwater (premier catamaran). Brest 2016 : CLS, 16/6/16